Reloger locataire : obligation travaux insalubres
-
 Xavier Revel
Xavier Revel - 30 Jul, 2025

Le relogement d’un locataire pendant les travaux est obligatoire si le logement devient inhabitable, notamment en cas d’insalubrité, de péril ou de manquement à l’obligation de décence. Le propriétaire doit alors proposer un logement équivalent, couvrir les frais et suspendre le loyer initial. Pour des travaux supérieurs à 21 jours, une réduction de loyer proportionnelle s’applique, même partiellement. Les assurances habitation ne prennent généralement pas en charge les relogements planifiés, laissant cette responsabilité au bailleur. En cas de désaccord, des recours existent, de la négociation au recours judiciaire, encadrés par la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du Code civil.
Vous devez reloger un locataire pendant des travaux et vous sentez perdu face aux obligations légales ? Ce guide clarifie les conditions de relogement obligatoire, les droits du locataire et les responsabilités du propriétaire, en fonction de la nature des travaux (comme les rénovations majeures rendant l’accès impossible ou les travaux liés à l’insalubrité) et de leur durée. Découvrez comment éviter les pièges juridiques et garantir un processus transparent, tout en respectant les textes de loi comme la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du Code civil, qui prévoit notamment une réduction de loyer au-delà de 21 jours de travaux.
- Reloger un locataire pendant les travaux : quand est-ce une obligation pour le propriétaire ?
- Travaux de plus de 21 jours : quels sont les droits du locataire ?
- Le processus de relogement : quelles sont les obligations du propriétaire ?
- Assurance habitation et relogement : qui paie la facture ?
- Procédure et recours : comment gérer la situation en pratique ?
Reloger un locataire pendant les travaux : quand est-ce une obligation pour le propriétaire ?
Lorsque des travaux sont entrepris dans un logement locatif, le propriétaire n’est pas systématiquement tenu de reloger le locataire. Cette obligation s’impose uniquement si les travaux rendent le logement inhabitable. Comprendre ces situations clés permet aux deux parties d’éviter des conflits inutiles et de respecter leurs obligations légales, notamment celles définies par le Code de la santé publique ou le décret de 2002 sur les conditions de décence.
En pratique, le relogement locataire concerne toutes les situations où le logement devient impropre à l’habitation : travaux lourds, risques sanitaires ou absence temporaire d’installations essentielles. Ce dispositif vise à protéger le droit du locataire à un logement décent pendant la durée des interventions.
Le critère clé : le logement devient-il inhabitable ?
L’obligation de relogement s’applique si les travaux compromettent les conditions essentielles de vie : impossibilité d’utiliser la cuisine, la salle de bain ou une chambre, coupure prolongée d’eau ou d’électricité (généralement supérieure à 48 heures), ou risques sanitaires (poussières toxiques, structures instables). Par exemple, des travaux générant des émanations d’amiante ou des infiltrations d’eau causant des moisissures dangereuses pour la santé relèvent de ce cadre. Le locataire doit alors être relogé ailleurs pendant la durée des travaux.
Les situations qui imposent un relogement obligatoire
- Travaux liés à l’insalubrité ou au péril : Si un arrêté préfectoral ou municipal ordonne des travaux pour insalubrité ou péril imminent, le relogement est obligatoire. Cela concerne les logements menaçant ruine, contaminés par des substances toxiques, ou exposant à des dangers sanitaires comme des fuites de gaz.
- Manquement à l’obligation de décence : Lorsque les travaux visent à corriger un défaut grave de décence (ex : absence de chauffage en hiver, salle de bain non fonctionnelle), le logement est non conforme au décret de 2002. D’autres exemples incluent un manque d’isolation thermique ou un défaut d’accès à l’eau chaude, rendant le logement inconfortable ou dangereux.
- Rénovations majeures rendant l’accès impossible : Des travaux comme la réfection complète du toit ou des murs porteurs, qui empêchent toute occupation sécurisée, exigent un relogement temporaire. Cela concerne aussi les rénovations électriques totales ou des fuites de gaz nécessitant l’évacuation des lieux.
Les travaux n’obligeant pas au relogement
Des travaux comme le ravalement de façade, la peinture des parties communes ou le remplacement de fenêtres dans une seule pièce ne rendent pas le logement inhabitable. Le locataire peut toutefois demander une réduction de loyer en cas de gêne, conformément à l’article 1716 du Code civil. Cette demande doit être justifiée par des preuves, comme des photos ou des attestations de tiers. Des travaux mineurs, comme l’installation d’un nouveau système de ventilation dans une cuisine ou la réparation d’une fuite localisée, n’entraînent pas non plus cette obligation.
Pour plus d’informations sur le relogement pendant les travaux, consultez l’article de référence de Cesdefrance, qui explique comment l’assurance habitation peut couvrir ces situations via des clauses prévoyant une indemnisation pour relogement temporaire, et les démarches à suivre pour en bénéficier.

Travaux de plus de 21 jours : quels sont les droits du locataire ?
Les travaux dans un logement locatif peuvent affecter la jouissance du bien par le locataire. La loi prévoit des protections spécifiques, notamment la règle des 21 jours encadrée par l’article 1724 du Code civil. Cette disposition garantit un équilibre entre les droits du bailleur et ceux du locataire, notamment en cas d’insalubrité ou de non-respect des conditions de décence obligeant le propriétaire à reloger.
La règle des 21 jours : une compensation financière obligatoire
Lorsque des travaux dépassent 21 jours, le locataire a droit à une réduction de loyer.
Si les réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé.
Cette règle s’applique que le logement soit partiellement ou totalement inaccessible. Les travaux d’insalubrité ou de mise aux normes de décence, rendant le bien inhabitable, entrent dans ce cadre. Selon l’article 1724 du Code civil, le locataire peut demander une compensation proportionnelle à la durée et à l’impact des travaux. Par exemple, des rénovations essentielles nécessitant l’interruption d’un service sont souvent concernées.
Comment est calculée la réduction de loyer ?
La réduction se calcule en fonction de deux critères :
- la durée des travaux au-delà du 21e jour
- la surface du logement rendue inutilisable
Exemple concret : pour un loyer de 800 €, si 25 % de la surface est inaccessible pendant 30 jours, la réduction s’applique sur les 9 jours excédentaires. Le calcul s’effectue généralement à l’amiable. En cas de désaccord, un juge peut fixer le montant en tenant compte des nuisances et des services indisponibles.
Le droit de résilier le bail
Si les travaux rendent le logement entièrement inhabitable, le locataire peut demander la résiliation judiciaire du bail, même avant les 21 jours. Cette mesure s’applique notamment en cas de dégradation sanitaire ou de conditions de décence non respectées.
Le locataire peut alors obtenir un relogement temporaire ou une résiliation sans pénalité. L’assurance habitation peut couvrir ces frais, selon les termes du contrat. Cette obligation du bailleur illustre l’importance de respecter les normes de sécurité et de confort, sous peine de sanctions légales.
✳️ Dès lors que les travaux rendent les lieux impropres à l’habitation, la question du relogement locataire pendant travaux doit être abordée clairement entre propriétaire et locataire, idéalement par écrit.
Le processus de relogement : quelles sont les obligations du propriétaire ?
Lorsque des travaux rendent un logement inhabitable en raison d’un manquement aux conditions de décence ou d’insalubrité, le propriétaire est légalement tenu de reloger son locataire. Cette obligation découle de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le relogement doit garantir un cadre de vie équivalent et respecter des critères précis pour éviter des désagréments excessifs. En cas de non-respect, le locataire peut demander une réduction de loyer ou engager une procédure judiciaire.
Proposer un logement décent et adapté
Le logement temporaire doit répondre aux caractéristiques d’un logement décent (article R111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation). Cela inclut une surface suffisante, une isolation thermique et acoustique adéquate, ainsi qu’un accès à l’eau chaude et à des sanitaires en bon état.
- Le nombre de pièces doit être équivalent à l’original.
- Il doit correspondre à la composition familiale (ex. : un couple avec enfants).
- Les frais de transport ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la situation précédente. Par exemple, un locataire travaillant à proximité de son logement initial ne doit pas être relogé à plus de 15 km de distance.
La prise en charge financière : loyer et frais annexes
Le propriétaire assume l’intégralité des coûts liés au relogement. Le bail du logement initial est suspendu pendant la durée des travaux. Ainsi :
- Le locataire ne paie pas le loyer du logement d’origine.
- Si le logement temporaire est plus onéreux, la différence est prise en charge par le propriétaire.
- Les frais de déménagement (aller-retour) et les frais d’ouverture de compteurs (eau, électricité, gaz) sont à la charge du bailleur.
- Le propriétaire doit également couvrir les coûts de stockage des biens du locataire si le logement temporaire ne permet pas de tout garder.
Notez que cette prise en charge peut être partiellement compensée par une assurance habitation. Certaines polices incluent une garantie “relogement d’urgence”, qui prend en charge les frais de location temporaire pendant les travaux.
💡 Il ne faut pas compter sur l’assurance habitation relogement pendant travaux pour remplacer l’obligation du bailleur : le relogement reste généralement à la charge du propriétaire quand les travaux rendent le logement inhabitable.
Synthèse des droits et devoirs de chacun
| Point de vigilance | Obligations du propriétaire | Droits et devoirs du locataire |
|---|---|---|
| Loyer | Prend en charge le loyer du logement temporaire. Couvre la différence si le nouveau loyer est plus élevé. | Ne paie pas le loyer initial pendant les travaux. |
| Frais de déménagement | Doit couvrir les frais aller-retour et les coûts annexes (compteurs, garde meuble, etc.). | Doit être remboursé des frais engagés. |
| Caractéristiques du logement | Propose un logement décent, équivalent en nombre de pièces et adapté aux besoins. | A le droit de refuser une offre inadaptée ou insalubre. |
| Durée | Informe le locataire de la durée prévisionnelle des travaux. | Doit libérer le logement initial pour permettre les travaux. |
Il est conseillé de formaliser les modalités du relogement par écrit, notamment la durée du séjour temporaire, les conditions de retour au logement initial, et les modalités de prise en charge financière. Cela évite tout litige ultérieur et garantit la transparence entre les parties.
Assurance habitation et relogement : qui paie la facture ?
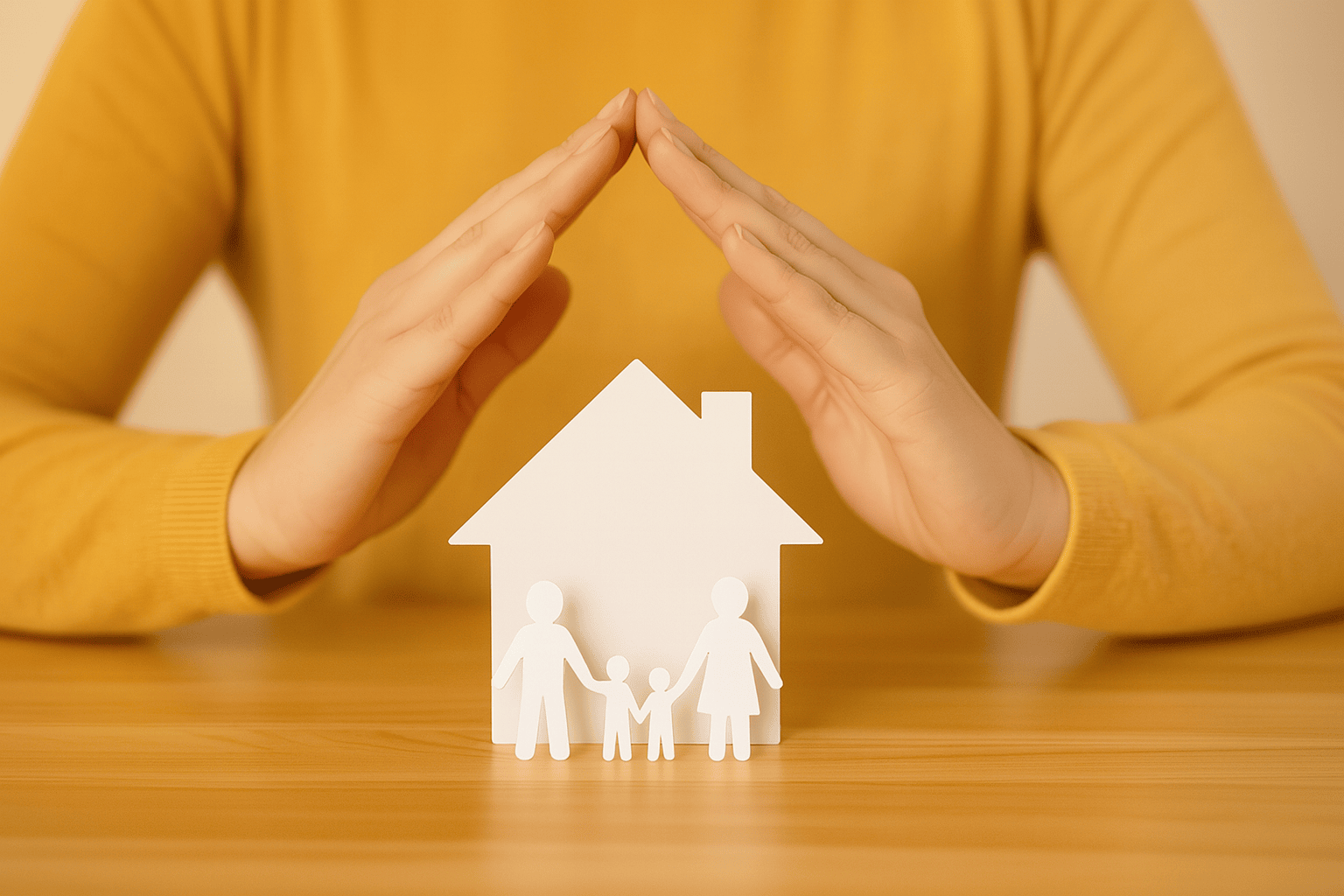
La garantie relogement de l’assurance habitation : une fausse bonne piste ?
La garantie relogement incluse dans l’assurance multirisques habitation (MRH) du locataire est souvent mal interprétée. Elle s’applique uniquement en cas de sinistre majeur, comme un incendie ou un dégât des eaux, et non pour des travaux planifiés.
Cette garantie indemnise généralement les frais de logement temporaire pendant une durée limitée (12 à 24 mois) et sous plafond financier (ex. 10 % du montant des garanties du contrat). Les locataires doivent donc clarifier cette nuance avant d’espérer un soutien financier de leur assureur.
Pour des travaux d’amélioration ou de rénovation, la responsabilité du relogement incombe au propriétaire, et non à l’assurance du locataire.
En cas de sinistre, le locataire doit déclarer l’événement dans les délais impartis et fournir des justificatifs (photos, devis). Sans événement imprévu, cette garantie reste inactive.
Et l’assurance du propriétaire (PNO) ?
L’assurance Propriétaire Non Occupant (PNO) protège principalement contre les dommages matériels ou les pertes de loyers liées à des sinistres. Les frais de relogement pour des travaux planifiés ne sont généralement pas inclus dans les contrats standards.
Seules les polices haut de gamme proposent des garanties spécifiques pour ce type de dépense. Ces clauses restent toutefois rares et doivent être expressément mentionnées dans le contrat. Elles peuvent couvrir le relogement si les travaux sont imposés par des normes légales (ex. mise aux normes électriques) ou des urgences sanitaires.
Les propriétaires doivent donc vérifier leurs conditions générales avant d’espérer une prise en charge. En absence de clause précise, le financement du relogement relève de leur responsabilité exclusive. Par exemple, des travaux d’isolation thermique ne donnent aucun droit à compensation par l’assurance.
La responsabilité civile : l’assurance qui peut intervenir
Si les travaux sont nécessaires pour corriger un manquement aux conditions de décence ou d’insalubrité, la responsabilité civile du propriétaire pourrait être engagée. Cette garantie couvre les conséquences de sa négligence antérieure.
Par exemple, des infiltrations d’eau dues à un toit mal entretenu ou des moisissures causées par un défaut de ventilation relèvent de cette responsabilité. L’assurance prendrait alors en charge les frais de relogement et les éventuels dommages subis par le locataire.
Pour cela, le locataire devra prouver que l’état dégradé du logement résulte d’une faute du bailleur. Ce scénario complexe nécessite souvent l’intervention d’un juriste spécialisé. En cas de litige, un expert judiciaire peut être désigné pour établir les responsabilités.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la garantie relogement de votre assurance, vous pouvez consulter ce guide détaillé sur l’assurance habitation et le relogement pendant travaux.
Procédure et recours : comment gérer la situation en pratique ?
La notification des travaux : une étape formelle et obligatoire
Le propriétaire doit informer le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception avant des travaux rendant le logement inhabitable. La notification doit inclure la nature des travaux, leur date de début, leur durée estimée, ainsi que les modalités de relogement. Cette étape est cruciale, car l’absence de notification écrite peut entraîner des sanctions légales. En cas de dépassement du délai prévu, le locataire peut demander une compensation financière ou un ajustement des conditions.
En cas de relogement, le locataire a droit à un logement équivalent en termes de surface, de localisation et de confort. Les modalités de paiement du loyer peuvent être modifiées : par exemple, une réduction de 10 à 30 % peut être appliquée si le relogement temporaire est moins pratique. Pour plus d’informations sur les garanties liées à l’assurance habitation, consultez l’article détaillé de Cesdefrance.
Que faire en cas de désaccord ?
Un désaccord sur les conditions de relogement ou la durée des travaux peut survenir. Voici les étapes à suivre pour résoudre le conflit :
- 1. Le dialogue et la négociation : Priorisez un échange direct pour trouver un accord sur le logement de remplacement ou une réduction de loyer. Par exemple, le locataire peut proposer un logement similaire dans le même quartier.
- 2. La mise en demeure : En cas d’échec, envoyez une lettre de mise en demeure pour exiger le respect des obligations légales. Celle-ci doit citer les clauses du bail et les textes de loi applicables, comme la loi du 6 juillet 1989.
- 3. La Commission Départementale de Conciliation : Saisissez cet organisme gratuit pour une médiation. Elle propose un cadre neutre pour faciliter un accord, souvent en moins de deux mois.
- 4. Le recours au juge : En dernier ressort, le juge des contentieux de la protection tranchera le litige. Il peut ordonner un relogement adapté ou une réduction de loyer proportionnelle aux désagréments subis.
Les textes de loi de référence
Deux textes encadrent cette situation : la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs et l’article 1724 du Code civil. La première impose au propriétaire de garantir un logement conforme aux conditions de décence (lumière, ventilation, sécurité). L’article 1724 du Code civil stipule qu’un logement devient inhabitable si les travaux rendent impossible son usage normal. Le locataire peut s’appuyer sur ces textes pour obtenir des solutions adaptées, y compris le droit de résilier le bail si le relogement n’est pas fourni.
En conclusion, reloger un locataire dépend de critères légaux (logement inhabitable, travaux >21 jours, arrêté de péril). Le propriétaire doit fournir un logement décent et couvrir les frais. L’assurance habitation ne s’applique qu’en cas de sinistre. Médiation ou recours légal résout les conflits. Connaître la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du Code civil évite les litiges.
FAQ
Qui est responsable du relogement d’un locataire pendant des travaux ?
Le propriétaire est légalement responsable du relogement si les travaux rendent le logement impropre à l’habitation. Cela inclut les situations où les parties essentielles (cuisine, salle de bain, chambre) sont inaccessibles, ou en cas de danger pour la sécurité. En ce sens, l’obligation incombe au bailleur, et non à l’assurance du locataire.
À quel moment un propriétaire doit-il reloger son locataire ?
Le relogement est obligatoire lorsque les travaux rendent le logement inhabitable, par exemple en cas de coupure prolongée d’eau ou d’électricité, ou de risques sanitaires. Cela s’applique également si les travaux sont ordonnés par un arrêté de péril ou liés à un manquement à l’obligation de décence. Le locataire doit alors être proposé un logement temporaire équivalent.
Qui prend en charge le relogement en cas de sinistre ?
En cas de sinistre (incendie, dégât des eaux), c’est l’assurance habitation du locataire (MRH) qui active la garantie relogement. Toutefois, cette couverture ne s’applique pas aux travaux planifiés par le propriétaire. Le bailleur reste donc financièrement responsable dans ce cas, et non l’assurance.
Comment demander un relogement pendant des travaux ?
Le locataire n’a pas à demander un relogement : c’est au propriétaire de l’initier s’il rend le logement inhabitable. En cas de désaccord, une lettre recommandée peut formaliser la demande, ou une saisine de la Commission Départementale de Conciliation. De cette manière, le locataire protège ses droits.
Qui paie les frais de relogement ?
Le propriétaire prend en charge l’ensemble des frais : loyer du logement temporaire (éventuellement supérieur), déménagement aller-retour, et ouverture des compteurs. Si le locataire doit supporter un surcoût, il peut demander une compensation. Il est important de noter que ces dépenses ne sont généralement pas couvertes par les assurances MRH ou PNO. Lorsque le relogement est imposé par des travaux lourds, ce n’est pas au locataire d’assumer les frais de relogement du locataire, mais bien au bailleur, sauf accord spécifique plus favorable au locataire.
Quel délai pour informer le locataire avant des travaux ?
Le propriétaire doit notifier les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant leur nature, dates et durée. Bien que la loi ne fixe pas de délai légal strict, une information au moins un mois avant le début des travaux est recommandée pour permettre au locataire de s’organiser.
Qu’est-ce qu’un relogement d’urgence pour un locataire ?
Il s’agit d’une relocation immédiate nécessaire en cas de danger imminent (effondrement, fuite de gaz). Le logement de remplacement doit être décent et adapté, avec un accès aux services essentiels. Le propriétaire doit également couvrir les frais annexes, comme les déplacements professionnels supplémentaires.
Quels droits pour un locataire en cas de gros travaux ?
- Réduction de loyer si les travaux durent plus de 21 jours (article 1724 du Code civil).
- Résiliation du bail si le logement est entièrement inhabitable.
- Refus d’un logement inadapté (ex : trop petit ou éloigné).
Peut-on expulser un locataire sans relogement ?
L’expulsion sans relogement est interdite si les travaux rendent le logement inhabitable. Toutefois, le bailleur peut résilier le contrat en cas de non-respect des termes du bail (ex : loyer impayé). Dans ce cas, le relogement n’est pas obligatoire, mais le locataire doit être informé selon les procédures légales.


